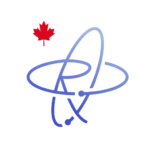Les séances et les résumés sont sujets à changement. Les résumés sont classés selon l’ordre dans lequel la présentation est prévue pour la séance.
- Mardi 27 Mai 2025
- Mercredi 28 Mai 2025
- Jeudi 29 Mai 2025
Mardi 27 Mai 2025
8:00 am - 9:00 am Conférencier principal - mardi (salle 2032)
Modératrice: Tara Hargreaves
Le projet Rhisotope – Utiliser la technologie nucléaire pour aider à réduire le braconnage des rhinocéros.
James Larkin | Unité de radioprotection, Université du WitwatersrandSalle 2032, 8 h 00 - 9 h 00
L’Afrique du Sud abrite 80 % de la population de rhinocéros blancs et noirs. Au cours des 150 dernières années, ces populations ont connu un déclin de près de 95 %, principalement dû à la perte de leur habitat et au braconnage. Les taux officiels actuels de braconnage s’élèvent à 3,2 % par année. Si ce nombre atteint 3,5 %, nous assisterons à un effondrement catastrophique de ces populations, au point où il n’y aurait plus de populations significatives dans la nature. La technologie nucléaire peut offrir un nouvel outil pour éviter que cela se produise. Et si nous rendions les cornes des rhinocéros radioactives ? Pas assez pour empoisonner l’utilisateur final, mais plutôt pour d’abord les empêcher de vouloir des cornes. La radiophobie est bien connue au sein de la communauté de radioprotection, les personnes surestiment généralement de façon radicale les dangers qu’une dose pourrait leur causer. Pourquoi ne pas utiliser cette peur contre ceux qui souhaitent posséder une corne de rhinocéros afin de démontrer leur richesse ou soigner une gueule de bois ? En réduisant la demande de cornes, le braconnage diminuera. Pas d’acheteur – pas de braconnage. La présence de la radioactivité signifie également qu’il est plus facile de détecter une corne qui a été prélevée lorsqu’elle franchit les frontières internationales et passe à travers les détecteurs de rayonnements qui y sont installés. En une simple opération, la corne devient moins désirable, les risques pour les contrebandiers augmentent, de même que les pénalités potentielles, et il n’est plus nécessaire d’écorner ces animaux pour assurer leur survie.
9:00 am - 10:00 am Séance A: Rayonnement neutronique provenant des déchets de remise à neuf des réacteurs CANDU
Modératrice: Julianna Liberatore
Rayonnement neutronique provenant des déchets de remise à neuf des réacteurs CANDU
Iain McDade & Tracey Millar | Centrale nucléaire de Bruce, Scott Stafford | OPGSalle 2032, 9 h - 10 h
Suite à l’identification d’un rayonnement neutronique imprévu provenant des déchets de remise à neuf des réacteurs CANDU et associé aux activités de retubage, un apprentissage à l’échelle de l’industrie a été réalisé. En ce qui concerne la centrale nucléaire de Bruce, nous présenterons une vue d’ensemble de ce qui s’est passé à la suite de l’identification de ce danger. La présentation passera en revue les points suivants :
- La notification, la réponse initiale et certains enseignements tirés de la réponse initiale.
- Les trois volets du suivi de l’événement, avec quelques détails de haut niveau sur chacun d’entre eux :
- L’enquête sur les causes fondamentales
- L’évaluation de l’historique de dosimétrie
- Le mécanisme de production de neutrons
- Actions futures/en cours pour résoudre le problème
10:30 am - 12:00 pm Présentations pour le Concours de communications étudiantes Anthony J. Mackay (Salle 2032)
Modératrice: Alicia Douglas
Amélioration de la scintigraphie pulmonaire à faible comptage par l’IA : Optimisation de la radioprotection et de l’efficacité de l’imagerie grâce aux cGAN
Amir Jabbarpour | Université CarletonRoom 2032, 10 h 30 - 10 h 50
Contexte
La scintigraphie pulmonaire ventilation/perfusion (V/Q) est un outil d’imagerie crucial pour le diagnostic de l’embolie pulmonaire (EP). La transition vers des acquisitions par tomographie d’émission monophotonique (SPECT) exclusivement présente des défis pour les clinicien·ne·s habitué·e·s à interpréter des scintigraphies pulmonaires planaires traditionnelles. De plus, les protocoles d’acquisition habituels pour les SPECT et la scintigraphie planaire V/Q, conçus pour produire des images de haute qualité prennent du temps et sont sujets à des artefacts dus aux mouvements du patient. Ceci peut mener à l’inconfort du ou de la patient·e et nécessite de répéter des examens afin d’obtenir des images cliniquement acceptables. Cette étude explore le potentiel des réseaux adverses génératifs conditionnels (cGANs) pour générer les images pseudoplanaires de haute qualité à partir de données de projection SPECT à faible dose ou d’images planaires ré-échantillonnées à faible comptage. En s’appuyant sur l’amélioration basée sur l’IA, cette approche vise à réduire considérablement la dose de rayonnements, à minimiser les artefacts dus aux mouvements du ou de la patient·e et à diminuer le besoin d’imagerie redondante, tout en préservant la précision du diagnostic.
Méthode
Nous avons analysé rétrospectivement 704 patients de L’Hôpital d’Ottawa ayant subi une scintigraphie V/Q pour une suspicion d’EP entre juin 2017 et janvier 2023. Seules les images de perfusion acquises en utilisant du technétium 99m MAA ont été incluses. Les images de perfusion ont été obtenues dans six projections habituelles – antérieure (ANT), postérieure (POST), oblique postérieure droite et gauche (RPO, LPO) et oblique antérieure droite et gauche (RAO, LAO) en utilisant huit appareils SPECT de deux fournisseurs. Chaque projection a été enregistrée jusqu’à ce qu’elle atteigne un total de 600 000 comptes en utilisant une matrice de 256 x 256. L’acquisition planaire a duré en moyenne 120,0 ± 54,7 secondes. L’acquisition SPECT a immédiatement suivi, utilisant 128 projections avec un temps d’acquisition de 8 secondes par arrêt et une matrice de 128 x 128. La projection SPECT correspondant le mieux à chaque projection planaire a été déterminée automatiquement en sélectionnant celle avec le coefficient de corrélation Pearson le plus élevé. Le rapport de comptage SPECT/planaire a été calculé et utilisé pour ré-échantillonner les images planaires en utilisant la méthode de Poisson, générant des images synthétiques à faible comptage avec des niveaux de bruit de Poisson correspondant aux projections SPECT.
Pour améliorer ces images à faible comptage, un réseau adverse génératif conditionnel (cGAN) a été formé à l’aide d’une fonction de perte L1+Perceptual+GAN sur 300 répétitions. L’ensemble des données d’entraînement était constitué d’images planaires synthétiques ré-échantillonnées associées à leurs images planaires à comptage complet correspondantes. Les valeurs d’intensité des images ont été normalisées entre 0 et 1 et les projections SPECT ont été suréchantillonnées dans une matrice 256 x 256 avant d’être introduites dans le cGan. Les ensembles d’entraînement, de validation et de test ont été créés avec une répartition de 80:10:10.
Pour évaluer les performances du modèle, l’erreur quadratique moyenne, le rapport signal/bruit de crête et la mesure d’indice de similarité structurelle ont été calculés, comparant les images synthétiques à faible comptage, les projections SPECT à faible comptage et leurs résultats améliorés par l’IA avec les images planaires à comptage élevé. Des comparaisons statistiques ont été effectuées à l’aide d’un test de la somme des rangs de Wilcoxon.
Résultats
Les rapports de comptage entre les projections planaire et SPECT étaient de 0,078 ± 0,047. Par inspection visuelle, nous montrons que les défauts de perfusion sous-segmentaires et segmentaires peuvent toujours être discernés après l’amélioration et qu’aucun nouveau défaut n’est introduit, démontrant que l’information diagnostique est préservée malgré une perte de comptage d’environ 10 fois. Les projections synthétiques et SPECT présentaient des paramètres de performance similaires avant et après l’amélioration par l’IA. Tous les paramètres de performance démontraient des améliorations significatives avec l’amélioration par l’IA. Plus précisément, pour la projection SPECT, la médiane ± l’écart interquartile de l’erreur quadratique moyenne a diminué de 0,59 ± 0,08 à 0,72 ± 0,07, le rapport signal/bruit de crête a augmenté de 21,1 ± 1,9 à 27,7 ± 1,6 et l’indice de similarité structurelle s’est amélioré de 7,75 × 10⁻³ ± 3,39 × 10⁻³ à 1,70 × 10⁻³ ± 8,70 × 10⁻⁴ ; tous les changements étant statistiquement significatifs (p < 10⁻⁵).
Conclusion
Le modèle cGAN proposé améliore efficacement les images par scintigraphies pulmonaires à faible comptage, générant des images pseudoplanaires de haute qualité à partir de données de projection SPECT à faible dose et d’images planaires ré-échantillonnées à faible comptage. Étant donné que les paradigmes de faible dose et d’acquisition rapide sont les deux faces d’une même médaille, le bruit de Poisson, qui dégrade la qualité de l’image et la fiabilité du diagnostic, l’amélioration par l’IA offre une solution cruciale. En atténuant les effets de bruit, cette approche permet de réduire l’activité radiopharmaceutique administrée, diminuant ainsi la dose absorbée par le ou la patient·e tout en préservant la précision du diagnostic. De plus, elle permet d’accélérer les protocoles d’acquisition, d’améliorer l’efficacité clinique, de réduire l’inconfort du ou de la patient·e et de minimiser les artefacts reliés aux mouvements. Les recherches futures exploreront son applicabilité aux études de ventilation, renforçant ainsi son rôle en optimisant l’imagerie en médecine nucléaire.
Amélioration de la surveillance de la dose oculaire en radioprotection : Évaluation de la Hp(0,07) et de la dosimétrie par luminescence stimulée optiquement (OSLD) comme alternative à la Hp(3)
Mina Manzoor | Université Ontario TechSalle 2032, 10 h 50 - 11 h 10
Contexte
L’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants est une préoccupation importante pour les travailleurs médicaux, en particulier pour ceux et celles évoluant en radiologie interventionnelle et en médecine nucléaire. La formation de cataractes induites par les rayonnements a conduit à des doses plus strictes pour le cristallin de l’œil, comme le recommande la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) [1]. Traditionnellement, la Hp(3) était la mesure préférée pour évaluer la dose à l’œil, mais en raison de la disponibilité limitée des dosimètres pour la Hp(3), la Hp(0,07) est souvent utilisée comme substitut [2].
Alors que les dosimètres thermoluminescents (DTL) ont été couramment utilisés pour la surveillance de la dose oculaire, les dosimètres luminescents stimulés optiquement (OSLD) offrent des avantages tels qu’une sensibilité accrue, une possibilité de réutilisation et des taux de dégradation plus faibles. Cette étude évalue la faisabilité d’utiliser la Hp(0,07) mesurée avec des OSLD comme alternative pour la surveillance de la dose oculaire en radioprotection. Plus spécifiquement, elle vise à :
- Évaluer la corrélation entre la Hp(0,07) et la Hp(3) en utilisant des OSLD dans des conditions d’irradiation contrôlées.
- Évaluer la précision de la dose d’un OSLD par rapport aux doses de référence Hp(3) dérivées de Monte-Carlo (MC).
- Étudier la réponse des OSLD à point quantique aux champs de photons et de rayonnements bêta.
- Développer et tester un prototype de système de recuit pour la réutilisation des OSLD.
- Optimiser les conditions de recuit pour une réinitialisation efficace de la dose en utilisant différentes sources de lumière DEL.
Méthode
Cette étude s’appuie sur le rapport EURADOS 2016 sur la dosimétrie du cristallin de l’œil [3], utilisant des irradiations photoniques et bêta pour évaluer les OSLD à points quantiques et inlight. Des expériences d’irradiation contrôlée ont été effectuées en utilisant un fantôme de l’œil en PMMA imprimé en 3D, sélectionné pour ses propriétés équivalentes à celles des tissus [4].
Pour les irradiations au photon, les valeurs de kerma dans l’air ont été converties en équivalents de la Hp(3) à l’aide de coefficients de conversion basés sur une simulation MC. Les OSLD ont été exposés et les mesures de doses ont été enregistrées en utilisant le système de lecture MicroStar. La précision a été évaluée en comparant les doses mesurées aux valeurs de la Hp(3) attendues, dérivées des conversions kerma dans l’air en Hp(3).
Pour les irradiations bêta, des sources bêta normalisées ont été utilisées pour examiner la réponse de l’OSLD pour différents spectres d’énergie bêta. Les caractéristiques de la réponse à la dose, y compris la dépendance énergétique et la dégradation du signal, ont été analysées pour déterminer la faisabilité des points quantiques pour une dosimétrie du cristallin précise dans ces champs de rayonnements mixtes [5].
Un recuiseur pour OSLD a été conçu pour réinitialiser les points quantiques irradiés pour plusieurs cycles de mesure. Le recuiseur utilise des sources lumineuses DEL bleues, vertes et blanches afin d’optimiser les conditions de recuit. Les essais expérimentaux ont évalué l’efficacité du recuit en exposant les points quantiques à des doses de rayonnements variables et en relisant les niveaux de dose à des intervalles de 5 minutes à l’aide du système MicroStar II. La source lumineuse la plus efficace a été déterminée en fonction du temps nécessaire pour réduire les niveaux de doses enregistrés en dessous des limites détectables [6].
Résultats
Les résultats préliminaires démontrent une corrélation forte entre la Hp(0,07) et la Hp(3), confirmant la faisabilité d’utiliser la Hp(0,07) comme substitut à l’évaluation de la dose à l’œil. Les mesures des OSLD ont montré des performances constantes pour différents champs de rayonnement avec des taux de dégradations plus faibles que les DTL traditionnels. Le recuiseur a réinitialisé les OSLD, éliminant les signaux résiduels et assurant des mesures de dose précises tout au long des cycles de réutilisation.
La lumière DEL bleue (470 nm) a obtenu le temps de recuit le plus rapide, réduisant les doses sous 8 Gy en moins de 30 minutes et les doses de près de 20 Gy en moins de 55 minutes. La lumière blanche a nécessité 40 minutes pour les doses sous 8 Gy et 70 minutes pour les doses d’environ 20 Gy. La lumière verte a été la moins efficace, nécessitant 90 et 140 minutes respectivement. Ces résultats suggèrent que la lumière DEL bleue est la méthode de recuit la plus efficace pour les OSLD à points quantiques, améliorant la réutilisabilité et réduisant les incertitudes de mesure.
Conclusion
Cette étude démontre que la Hp(0,07) peut servir d’alternative viable à la Hp(3) dans l’évaluation de la dose à l’œil et souligne les avantages des OSLD sur les DTL conventionnels en radioprotection. La mise en œuvre d’un système de surveillance basé sur les OSLD, combiné à un procédé de recuit efficace pourrait améliorer la précision et l’efficacité des programmes de surveillance de la dose aux cristallins.
L’élaboration d’un recuiseur d’OSLD à faible coût renforce davantage la faisabilité d’intégrer des OSLD à points quantiques dans la surveillance de routine. L’utilisation de lumière DEL bleue pour le recuit réduit considérablement le temps de traitement, permettant une réutilisation rapide et efficace des dosimètres. Des recherches supplémentaires devraient affiner les méthodologies d’étalonnage, valider les résultats dans les environnements professionnels réels et explorer les effets à long terme du recuit sur la sensibilité des OSLD.
Références
[1] ICRP, "ICRP Publication 118: Radiation Dose to the Lens of the Eye," 2012.
[2] R. Behrens and G. Dietze, "Personal dosimeters for eye lens dosimetry," Radiation Protection Dosimetry, vol. 139, no. 1-3, pp. 325-331, 2010.
[3] R. Behrens et al., "EURADOS Report 2016: Eye lens dosimetry," Radiation Protection Dosimetry, vol. 172, no. 1-3, pp. 21-28, 2016.
[4] ICRU, "Tissue Substitutes in Radiation Dosimetry and Measurement," ICRU Report 44, 1989.
[5] S. Jang et al., "Characterization of OSLD response to beta radiation," Radiation Measurements, vol. 122, pp. 106190, 2019.
[6] J.-H. Kim et al., "Evaluation of blue LED light annealing in Al2O3:C for radiation dosimetry," Journal of Luminescence, vol. 138, pp. 147-153, 2013.
Évaluation de la dose au cristallin pour les technologues en médecine nucléaire et en TEP.
Olivia Sharp | Université de Toronto et The Michener Institute of Education du Réseau universitaire de santéSalle 2032, 11 h 10 - 11 h 30
Contexte
En 2021, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a ajusté la limite de dose équivalente pour le cristallin à 50 mSv pour une période d’un an en se basant sur la recommandation faite par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). C’était une réduction importante en comparaison avec la limite précédente de 150 mSv en un an. La CCSN a suggéré d’examiner les risques sur les lieux de travail afin de déterminer si des pratiques sécuritaires supplémentaires nécessitaient d’être implantées pour protéger le cristallin. Les situations causant un risque accru ont été mentionnées par la CCSN, comme les personnes soumises à une exposition non uniforme à l’œil et les personnes exposées aux rayonnements faiblement pénétrants. Des champs non uniformes peuvent se produire lorsque le tronc du corps est protégé, mais pas les yeux et lorsque la tête est plus proche de la source que le corps. Par exemple, lors de l’examen ou de la préparation d’une seringue contenant un isotope pour des procédures en médecine nucléaire ou en TEP. L’objectif est d’examiner l’exposition du cristallin et de la comparer aux doses enregistrées par les dosimètres pour le corps entier.
Méthode
Au total, huit travailleur·euse·s en MN et en TEP ont reçu des dosimètres oculaires Mirion Type 27 (LiF:Mg, Ti puce DTL100) à porter pour environ deux trimestres (6 mois). Ceux-ci ont été portés avec les DTL personnels pour le corps entier et pour extrémités préalablement assignés. Les membres du personnel ayant les doses équivalentes les plus élevées provenant des activités autorisées par la CCSN ont été sélectionnés. Les dosimètres ont été portés près de l’œil sur le devant de la tête. Les travailleur·euse·s ont reçu des lunettes de sécurité sur lesquelles était attaché un dosimètre oculaire ou une seconde option consistait à fixer le dosimètre à un masque médical à une distance approximativement égale du cristallin de l’œil. Il est important de noter que le personnel effectue une rotation entre les zones de TEP et de MN. Au premier trimestre, un seul dosimètre par personne avait été assigné pour les deux zones. Au second trimestre, un dosimètre a été assigné pour chaque zone (2 par personne) et les résultats de doses ont été additionnés. Le nombre de procédures effectuées par les travailleur·euse·s a été recueilli et pris en compte.
Résultats
Les doses théoriques ont été calculées de manière prudente afin d’inclure l’exposition des dosimètres pour le corps entier. Ceci a été considéré comme une dose supplémentaire encourue par trimestre en raison des champs non uniformes (lorsque la tête était plus proche de la source que le dosimètre pour le corps entier sur le torse, à 50 cm de distance). Il a été supposé que chaque membre du personnel avait passé un maximum de 10 secondes à une distance source-œil de 10 cm par procédure. Ceci se produit lors du transfert du matériel de la réception au L-Block, en se penchant au L-Block pour mieux voir lors du retrait d’une dose, ou lors d’une brève exposition au moment de l’administration au patient par intraveineuse. Le personnel mesurant approximativement 1,5 m (5 pieds) ou moins a noté des problèmes pour voir l’activité prélevée dans la seringue au travers du L-Block et a utilisé un tabouret. De même, le personnel de grande taille est potentiellement exposé lorsqu’il regarde au-dessus du L-Block. Une exposition oculaire non protégée de 10 secondes est cependant une estimation prudente pour chaque procédure effectuée et les facteurs de blindage autres que la seringue/fiole ne sont pas pris en compte dans les calculs.
Les résultats des DTL oculaires de Mirion pour une partie du 1er et du 2e trimestres de 2024 ont confirmé les estimations pour le personnel surveillé. Les trois expositions trimestrielles les plus élevées étaient de 2,48 mSv, 2,15 mSv et 1,97 mSv. En extrapolant prudemment pour quatre trimestres, les résultats de dose aux cristallins sont légèrement sous la valeur de 10 mSv annuellement et bien en deçà de la limite de dose au cristallin de 50 mSv/an. En comparant les résultats des DTL oculaires avec les résultats des DTL pour le corps entier (en mSv) pour le 2e trimestre, on peut voir que les résultats pour le corps entier s’alignent bien avec les résultats de dose au cristallin. Pour les porteur·euse·s 001, 002, 003, 004 et 008, la différence entre la dose pour le corps entier et la dose au cristallin ne varie que de 0,07 à 0,64 mSv. Les résultats des porteur·euse·s 005, 006 et 007 ne sont pas concluants puisque 2 DTL oculaires de la zone TEP et un DTL oculaire de la zone MN ont été perdus ou n’ont pas été traités. Pour les personnes qui ne sont pas concernées par les isotopes de TEP, le risque de dose est plus faible. Ceci est évident pour les résultats des DTL oculaires du 2e trimestre de 2024, car les personnes les plus exposées ont reçu la majorité de leur dose de la zone de TEP (2,08 mSv, 1,59 mSv et 1,72 mSv, respectivement).
Conclusion
En se basant sur une revue de la littérature et des estimations calculées, le personnel de MN et de TEP ne devrait pas excéder la dose limite de la CCSN de 50 mSv/an. Il est intéressant de noter que les procédures de TEP contribuent à une exposition oculaire plus élevée. Étant donné que les doses mesurées et calculées s’alignent pour les yeux et pour le corps entier, il est possible de recommander que les dosimètres pour le corps entier soient également représentatifs de la dose au cristallin.
1:30 pm - 3:00 pm Séance B: Appareils à rayonnement
Modérateur: Ryan Cooke
Caractérisation du terme source des déchets de faible activité CANDU pour le tri et le recyclage des matériaux énergétiques propres
Lionel Fernandes | Laurentis Energy PartnersSalle 2035/2036, 13 h 50 - 14 h 10
Les déchets radioactifs de faible activité (DFA) produits par les réacteurs CANDU, qu’ils soient opérationnels ou anciens, sont surveillés, inventoriés et triés au laboratoire de tri et de recyclage des matériaux énergétiques propres (CMSR), un projet conjoint de Laurentis Energy Partners (Laurentis) et de l’Université McMaster. Au laboratoire CMSR, des frottis et des frottis de grandes surfaces de matériaux de DFA contaminés et d’échantillons solides de DFA ont été prélevés pour analyse. Compte tenu du nombre d’échantillons de DFA de l’initiative de recherche, on estime qu’il s’agit de la caractérisation du terme source la plus significative statistiquement à ce jour pour les DFA produits par le CANDU.
Cette initiative de recherche a démontré l’intérêt du tri et de la ségrégation pour la minimisation du volume des DFA. Cela s’étend à l’amélioration des techniques de tri, à l’optimisation de l’espace des conteneurs de déchets, ainsi qu’à l’identification des matériaux non contaminés dans les DFA de CANDU.
La présence d’isotopes industriels standard (p. ex., Cs 137 et Co 60) a été confirmée en abondance relativement élevée dans tous les types de déchets et dans les échantillons de DFA anciens, comme prévu. Cependant, la distribution des autres radionucléides associés aux DFA était très variable et généralement en abondance bien inférieure aux prévisions (voire inexistante). L’application de l’estimation du débit de dose à la radioactivité, bien qu’efficace et techniquement solide, a généralement pour effet de surestimer et de surcaractériser les DFA produits par les CANDU.
Comme prévu, la norme de quantification de la radioactivité des bacs de DFA demeure prudente, avec des valeurs supérieures à celles mesurées individuellement (correction de la signature gamma par rapport à la radioactivité).
Bien qu’un nombre important d’échantillons ait été prélevé au cours de ce projet, une collecte supplémentaire d’échantillons est recommandée afin d’augmenter la taille de l’échantillon des DFA anciens qui étaient peu fréquemment ou pas disponibles au cours de l’étude.
Faire évoluer les plans pour l’élimination des déchets canadiens de moyenne et de haute activité dans des dépôts géologiques en profondeur
Chantal Medri | Société de gestion des déchets nucléairesSalle 2035/2036, 14 h 10 - 14 h 30
En vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, le mandat initial de la SGDN était d’élaborer et de mettre en œuvre un plan canadien pour la gestion sécuritaire et à long terme du combustible nucléaire irradié. Le processus de sélection du site pour ce dépôt a été lancé en 2010 et a culminé en 2024 avec la sélection du site de Revell, entre Ignace et Dryden, sur le territoire traditionnel de la Nation ojibwée du lac Wabigoon. Les prochaines étapes impliquent une série d’activités notamment les évaluations détaillées du site, l’achèvement des processus réglementaires requis, la préparation de la construction et éventuellement l’exploitation de l’installation.
Alors que le plan canadien de gestion du combustible nucléaire irradié progresse, la SGDN s’est lancée dans une nouvelle entreprise. Suite à la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs (SIDR), élaborée par la SGDN et acceptée par le ministre des Ressources naturelles du Canada en 2023, la SGDN est désormais responsable de l’évacuation des déchets canadiens de moyenne activité et des déchets de haute activité non combustibles dans un dépôt géologique en profondeur. Dans un premier temps, et en s’appuyant sur son expérience, cette nouvelle tâche exige de la SGDN qu’elle élabore un processus visant à trouver un emplacement sûr et socialement acceptable pour le second dépôt, avec des hôtes informés et consentants.
Le paysage technologique, environnemental et politique du Canada évolue rapidement. Dans ce contexte évolutif, il est possible de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires existantes et de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Si ces projets sont mis en œuvre, ils entraîneront des volumes supplémentaires de déchets de haute et de moyenne activité, qui devront être gérés de manière sécuritaire dans un dépôt géologique en profondeur, à long terme. La SGDN considère les futurs déchets issus de nouveaux projets nucléaires et élabore des plans à long terme qui les incluent.
Cette présentation fera le point sur les activités et les projets de la SGDN.
Amélioration de la précision et de la reproductibilité d’un étalonneur en boîter autoblindé
Dania Shahin | Université McMasterSalle 2032, 13 h 30 - 13 h 50
Le département de radioprotection de l’Université McMaster fournit une assistance en matière de radioprotection à un large éventail d’utilisateurs, tant internes qu’externes à l’université. Dans le cadre d’un effort visant à améliorer nos services, nous avons récemment acquis un étalonneur en boîtier autoblindé, modèle 89 de JL Shepherd & Associates, contenant une source de césium 137. Ceci est une approche efficace et conventionnelle pour l’étalonnage des instruments de mesure de rayonnements, permettant d’étalonner tous les types d’instruments portables et de sondes de détection de rayonnement. Cependant, le positionnement précis et reproductible des instruments par rapport à la source de Cs-137 interne de l’étalonneur reste un défi, car même de légères variations de position peuvent entraîner des fluctuations dans les mesures du débit de dose. Dès la réception de l’étalonneur en boîtier, plusieurs projets ont été initiés afin d’assurer la précision et la reproductibilité des étalonnages. La première initiative majeure a été d’élaborer des gabarits 3D sur mesure pour chaque instrument de mesure de rayonnements, ainsi qu’un système de grille et chevilles imprimé en 3D assurant un positionnement spatial précis et reproductible. Deuxièmement, un système électronique automatisé de positionnement de table a été installé pour contrôler les mouvements de position de l’instrument à l’intérieur de l’étalonneur, remplaçant ainsi le système manuel à manivelle externe et l’indicateur de position analogique. Enfin, une chambre d’ionisation adaptée à une utilisation comme étalon a été achetée et est étalonnée annuellement par les Services d’étalonnage de rayonnements ionisants du Laboratoire national de recherche du Canada. Cela permet de vérifier les débits de dose réels dans l’étalonneur, au lieu de se fier exclusivement aux courbes de décroissance. Chacune de ces actions a permis d’apporter des améliorations évolutives et rentables à l’étalonneur existant, tout en modernisant et en améliorant l’appareil, garantissant ainsi que McMaster est bien équipé pour effectuer un étalonnage de qualité pour nos utilisateurs internes et nos parties prenantes associées.
1:30 pm - 3:00 pm Séance C: Déchets
Modérateur: Chris Malcolmson
Évaluation de la performance du détecteur de rayonnements portable Radiacode 103
Bryan McIntosh | Action cancer ManitobaSalle 2032, 14 h 30 - 14 h 50
Ces dernières années, la disponibilité des radiamètres directement auprès des vendeurs sur Internet s’est accrue, de même que l’intérêt pour la vérification des objets et des zones pour une contamination radioactive. Nous avons ainsi constaté une augmentation du nombre de personnes possédant un détecteur de rayonnement au sein du grand public. Ces appareils de mesure se limitent souvent à des compteurs Geiger qui ne permettent pas d’identifier les isotopes.
La compagnie chypriote Radiacode a commercialisé une série de détecteurs pour le grand public basés sur des scintillateurs CsI ou GAGG couplés à de petits photomultiplicateurs en silicium. Radiacode revendique une résolution énergétique élevée pour la spectroscopie gamma, ainsi qu’une sensibilité élevée pour les mesures de débits de dose. Le détecteur se connecte également à une application sur téléphone intelligent permettant l’analyse plus détaillée des données et la localisation des mesures.
Cette présentation montrera les résultats de notre caractérisation du Radiacode 103 de milieu de gamme à travers une série de tests incluant la sensibilité de l’appareil, la précision à travers une gamme de différents débits de dose et sa capacité à identifier les différents radioisotopes communs en comparaison avec des appareils plus coûteux destinés à des usages professionnels. Nous commenterons également les performances de l’application sur différents téléphones intelligents afin de déterminer l’utilité des fonctionnalités de l’appareil. Finalement, nous fournirons une évaluation complète de la pertinence de ces appareils pour une utilisation dans un cadre professionnel, particulièrement en considérant leur prix accessible.
LightLink® – Avancées dans la technologie des détecteurs basés sur des scintillateurs plastiques pour les radiations α, β et γ.
Ralph Bose | Mirion TechnologiesSalle 2032, 14 h 10 - 14 h 30
Les scintillateurs plastiques couplés à des tubes photomultiplicateurs (TPM) ont servi de détecteurs fiables de grande surface pour les rayonnements α et β ainsi que de détecteurs de grand volume pour les rayonnements γ pendant de nombreuses années. Cette contribution résume les technologies conventionnelles des détecteurs à scintillation plastique et explore les progrès récents réalisés dans la technologie des détecteurs grâce à l’intégration de diodes à avalanche à photon unique (SPAD), en particulier les photomultiplicateurs en silicium (SiPM). L’utilisation des SiPM apporte une multitude d’avantages par rapport aux détecteurs traditionnels, allant de la réduction de la taille et des besoins en énergie à une robustesse accrue. Cette présentation fournit un aperçu des aspects techniques de ces avancées, en expliquant les principes derrière la technologie appelée LightLink®, des détecteurs à scintillateur plastique basés sur des SiPM et leurs caractéristiques uniques.
La discussion englobe les implications pratiques de ces avancées, en explorant leur impact sur le développement de produits innovants pour la détection des rayonnements ionisants. Les applications des détecteurs à scintillateur plastique basé sur la technologie LightLink® dans divers domaines y compris les détecteurs portables et les moniteurs de contamination seront élucidées, mettant en lumière la polyvalence et l’efficacité de cette évolution technologique. L’objectif de cette contribution est de fournir un aperçu des développements récents dans la technologie des détecteurs à scintillateur plastique, en mettant l’accent sur le rôle crucial joué par les détecteurs LightLink® et en offrant des perspectives sur leurs applications futures potentielles.
Techniques de restauration de l’empilement d’impulsions pour la spectroscopie gamma à haut débit avec des détecteurs à scintillation LaBr3(Ce)
Kostandinos Gianicos | Université McMasterSalle 2032, 13 h 50 - 14 h 10
La spectroscopie gamma est limitée par les effets d’empilement d’impulsions, qui se produisent lorsque des événements de détection de rayonnements arrivent en succession rapide, entraînant le chevauchement des contributions de signaux provenant d’événements individuels. Traditionnellement, les événements d’empilement sont écartés par un algorithme de détection d’empilement, car les événements d’empilement déforment le spectre de hauteur d’impulsion. Cela atténue la dégradation de la résolution énergétique, mais augmente considérablement le temps mort du système de détection à des débits de comptage élevés, qui sont souvent rencontrés dans les mesures des spectres gamma dans les zones d’entretien et les lieux de remise à neuf des CANDU. Afin de résoudre ceci, nous développons un algorithme de restauration de l’empilement d’impulsions qui identifie et restaure les informations de hauteur d’impulsions à partir des événements de chevauchement pour les scintillateurs LaBr3(Ce). Pour optimiser l’algorithme de restauration de l’empilement d’impulsions, un outil de simulation a été élaboré pour raffiner et évaluer la performance de l’algorithme de restauration dans différentes situations d’empilement. L’outil génère des formes d’impulsion synthétiques afin de simuler des données de forme d’onde impulsée à différents débits de comptage. Les temps de montée et de décroissance ont été ajustés pour correspondre aux formes de l’impulsion attendues du LaBr3(Ce), créant un environnement de simulation réaliste. Pour complémenter les études de simulation, les formes d’onde d’impulsion ont été collectées en utilisant un détecteur LaBr3(Ce) avec un numériseur commercial à haute vitesse. L’installation a été configurée avec et sans préamplificateur afin de fournir un ensemble de données variées pour l’élaboration de l’algorithme. L’analyse des données simulées et expérimentales effectuées après traitement démontre que l’algorithme de restauration rétablit efficacement les hauteurs d’impulsion pour les événements avec ou sans empilement. Les travaux en cours se concentreront sur la collecte d’impulsions provenant de sources à débit élevé, jusqu’à un million de comptes par seconde et sur la mise en œuvre de cet algorithme sur une matrice prédiffusée programmable par l’utilisateur (FPGA) pour la spectroscopie en temps réel.
Pratiques de la radioprotection et de la gestion de l’environnement : Aperçu de l’Initiative de la région de Port Hope
Adetayo Onikosi | Laboratoires Nucléaires CanadiensSalle 2035/2036, 13 h 30 - 13 h 50
L’Initiative de la région de Port Hope (IRPH) est l’un des plus grands projets d’assainissement de l’environnement au Canada, axée sur une gestion sécuritaire des déchets radioactifs historiques de faible activité tout en accordant la priorité à la radioprotection et à la responsabilité environnementale. Cette présentation explorera les principales pratiques de radioprotection (RP) utilisées dans le projet et partagera des perspectives sur la façon dont ces mesures contribuent à équilibrer la sécurité des travailleur·euse·s, la conformité réglementaire et la gestion environnementale.
L’IRPH a mis en œuvre un programme de radioprotection (PRP) complet pour protéger les travailleur·euse·s, le public et l’environnement tout en effectuant un assainissement radiologique complexe des sites et des propriétés résidentielles privées dans les municipalités de Port Hope et Clarington. Cela comprend la surveillance des rayonnements et des doses, la surveillance de l’air et les mesures de contrôle de la contamination sur les sites critiques tels que l’installation de gestion à long terme des déchets de Port Hope (IGLT PH). En suivant le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable, aussi bas que raisonnablement possible), le projet garantit que l’exposition aux rayonnements est réduite au minimum tout en respectant la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).
Au-delà de la radioprotection, cette présentation mettra en évidence la manière dont la gestion de l’environnement est intégrée dans les opérations de l’IRPH. Une caractérisation minutieuse des déchets, un confinement technique et des stratégies de gestion de l’assainissement adaptées contribuent à minimiser l’impact environnemental. Une collaboration continue avec les instances de réglementation, les parties prenantes et la communauté locale a également joué un rôle clé dans le maintien de la transparence et de la confiance du public.
Les leçons tirées de l’IRPH offrent des enseignements précieux pour d’autres projets d’assainissement environnemental à grande échelle. En intégrant de solides mesures de radioprotection à une gestion environnementale responsable, l’initiative démontre comment des efforts de nettoyage complexes peuvent être menés de manière sécuritaire, efficace et durable.
3:30 pm - 5:00 pm Séance D: Radioprotection des patients
Modératrice: Manon Rouleau
Une revue systématique du cancer de la thyroïde et des maladies liées à l’exposition aux rayonnements à l’âge adulte
Addie Ivanova | Commission canadienne de sûreté nucléaireSalle 2032, 15 h 50 - 16 h 10
La thyroïde régule de nombreuses fonctions vitales de l’organisme, notamment la croissance, le métabolisme, la reproduction, le rythme cardiaque, la tension artérielle et la température corporelle. La glande thyroïde est vulnérable aux rayonnements ionisants, le cancer étant le principal effet sur la santé après une exposition faible à modérée. Une relation dose-réponse linéaire entre l’exposition aux rayonnements pendant l’enfance et le cancer de la thyroïde est bien documentée et des données probantes indiquent que l’exposition est également associée à des maladies thyroïdiennes bénignes, comme l’hypothyroïdie. Cependant, la littérature portant sur le risque de cancer de la thyroïde ou de maladies bénignes après une exposition à l’âge adulte est plus variable et pourrait être mieux définie.
La relation entre les rayonnements ionisants et les maladies thyroïdiennes constitue un enjeu réglementaire important. Lors d’urgences radiologiques ou nucléaires, l’exposition du public ou des professionnel·le·s pourrait entraîner l’incorporation d’iode radioactif par la thyroïde. À ce titre, la Commission internationale de protection radiologique a recommandé des niveaux de référence pour les urgences, tandis que Santé Canada a établi des critères génériques qui comprennent des indications sur le moment opportun pour prendre des mesures de protection, comme le blocage thyroïdien à l’iode stable. De plus, les déversements accidentels (en laboratoire, par exemple) pourraient entraîner des doses professionnelles avec des incorporations d’iode radioactif. Bien que ces événements soient rares, la compréhension des risques dans ces contextes, en particulier pour la population adulte, demeure insuffisante, ce qui pourrait avoir d’importantes implications réglementaires lors de la gestion des urgences. Par exemple, certains pays ne distribuent pas d’iodure de potassium aux personnes plus âgées, tandis que d’autres choisissent de le faire à des fins de communication des risques.
Compte tenu des incertitudes qui subsistent, la CCSN a entrepris un examen systématique afin d’améliorer le niveau de compréhension du risque d’exposition de la thyroïde aux rayonnements ionisants à l’âge adulte, ce qui pourrait éclairer le cadre de la radioprotection. Cette présentation vise à décrire le processus de révision, les progrès réalisés, les défis rencontrés et les résultats obtenus à ce jour.
Évaluation de l’UNSCEAR sur le second cancer primaire après la radiothérapie
Jing Chen | Santé CanadaSalle 2032, 15 h 30 - 15 h 50
Le Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) a été créé en 1955 par l’Assemblée générale des Nations Unies, avec le mandat d’évaluer les données scientifiques les plus récentes sur les niveaux, les effets et les risques d’expositions aux rayonnements ionisants sur les êtres humains et l’environnement et de fournir une base scientifique indépendante, objective et actualisée en matière de radioprotection. Les rayonnements ionisants sont utilisés pour traiter le cancer depuis plus d’un siècle et sont principalement administrés par faisceau externe, représentant environ 50 % de l’ensemble des traitements contre le cancer. Environ 40 % des personnes ayant guéri d’un cancer ont reçu une radiothérapie dans le cadre de leur traitement.
En 2017, le comité scientifique a approuvé un plan visant à évaluer l’incidence d’un second cancer primaire (SCP) après la radiothérapie. L’objectif était de sensibiliser les communautés scientifiques et médicales, ainsi que les autorités nationales du fait que le traitement du cancer par radiothérapie, bien qu’il permette de soigner efficacement un nombre croissant de patient·e·s, pouvait entraîner dans certains cas des expositions hors cible entraînant l’apparition d’un SCP plusieurs années plus tard.
L’analyse de la documentation pertinente par le comité indique qu’entre 5 % et 15 % des personnes ayant survécu à un cancer sont susceptibles de développer un second cancer primaire. Cependant, il a estimé que seule une petite proportion de la totalité des seconds cancers primaires était susceptible d’être attribuée à la radiothérapie. L’évaluation du comité a permis d’affiner la compréhension générale du nombre de second cancer primaire pouvant être attribué à la radiothérapie. Les chiffres absolus dépendent des tissus spécifiques à risque et des doses de rayonnements ionisants reçues pendant le traitement par radiothérapie. Compte tenu des avantages considérables de la radiothérapie, les patient·e·s souffrant d’un cancer ne devraient pas être dissuadés de recevoir une radiothérapie uniquement par crainte qu’un SCP ne se développe. Néanmoins, la conception et le développement futur de la radiothérapie devraient prévoir des mesures spécifiques pour réduire l’induction d’un second cancer primaire.
Optimiser la radioprotection dans la thérapie radiopharmaceutique à base de Lutécium 177 : Nécessité d’une dosimétrie interne normalisée
Pardis Haghi | Université Ontario TechSalle 2032, 16 h 10 - 16 h 30
La thérapie radiopharmaceutique (TRP) au Lutécium 177 (¹⁷⁷Lu) a révolutionné le traitement ciblé du cancer, offrant des capacités théragnostiques intégrant le diagnostic et la thérapie. Toutefois, garantir la radioprotection des patient·e·s, des travailleur·euse·s de la santé et de l’environnement reste un défi majeur. Cette étude examine les mesures de radioprotection et les exigences réglementaires d’une TRP à base de ¹⁷⁷Lu au Canada, en se concentrant sur l’autorisation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), les protocoles de conformité et les mesures d’assurance de la qualité pour atténuer les risques d’exposition aux rayonnements.
Un élément clé de la sécurité des patient·e·s en médecine nucléaire est la dosimétrie interne, qui joue un rôle crucial dans l’optimisation de l’efficacité du traitement tout en minimisant l’exposition aux rayonnements des tissus sains. Malgré les progrès de la médecine nucléaire, de nombreux protocoles de traitement continuent de reposer sur des approches à dose fixe, entraînant des résultats thérapeutiques sous-optimaux. Cette recherche explore les défis et les incitations de la dosimétrie spécifique au ou à la patient·e, y compris les obstacles tels que le coût, le manque de protocoles standardisés et les incertitudes de la dose-réponse. De plus, elle évalue différents algorithmes de prescription de dose, en comparant les approches de dosage fixe, de dose absorbée maximale tolérée et de dose prescrite absorbée par la tumeur dans les applications cliniques.
Les résultats soulignent le besoin urgent de plateformes logicielles normalisées pour l’évaluation des doses internes afin d’améliorer la planification des traitements personnalisés et les stratégies de radioprotection. L’absence d’un cadre universel de dosimétrie a entraîné des incohérences dans le calcul des doses, ce qui a eu un impact sur la précision de l’administration des rayonnements thérapeutiques. Les progrès futurs devraient se concentrer sur le développement d’un nombre limité de plateformes de dosimétrie disponibles commercialement et accessibles à tous les services de médecine nucléaire. Ces plateformes doivent garantir des résultats cohérents et reproductibles pour les doses absorbées par les organes cibles, les doses efficaces pour le corps entier et les histogrammes de volume de dose. De plus, l’adoption d’un format de données normalisé (p. ex. DICOM) améliorera l’interopérabilité, permettant un échange de données transparent entre les cliniques et les établissements. L’implantation de ces améliorations renforcera la sécurité des patients, maximisera les bénéfices thérapeutiques et minimisera les risques liés aux rayonnements dans le domaine en pleine évolution de la thérapie radiopharmaceutique.
Les dangers externes des particules alpha
Jon Aro | Commission canadienne de sûreté nucléaireSalle 2032, 16 h 30 - 16 h 50
En novembre 2024, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a envoyé un courriel aux titulaires de permis, les informant que les particules alpha d’une énergie supérieure à 7 MeV pouvaient entraîner une dose importante à la peau. Ceci représente un changement radical dans notre compréhension des dangers externes associés aux particules alpha.
Cette découverte coïncide également avec l’augmentation significative de l’utilisation d’émetteurs alpha en médecine, en recherche et dans le secteur du traitement d’isotopes utilisés dans le domaine de la thérapie alpha ciblée. En particulier, la disponibilité et l’utilisation d’actinium 225 par les titulaires de permis à travers le Canada ont augmenté.
Cette présentation abordera les fondements scientifiques de notre nouvelle compréhension des dangers, l’impact sur les titulaires de permis qui manipuleront des émetteurs alpha et les directives de la CCSN à l’intention des titulaires de permis.
3:30 pm - 5:00 pm Séance E: Déclassement
Modératrice: Ye Eun Kim
Déclassement de sites nucléaires complexes
Mike Grey | KinetricsSalle 2035/2036, 15 h 30 - 15 h 50
Un site nucléaire complexe est un site qui regroupe plusieurs installations nucléaires sur un même emplacement. Souvent, ces installations comprennent différents types d’infrastructures (par exemple, des réacteurs, des installations de traitement et de stockage d’eau lourde, ainsi que des installations de gestion des déchets) à divers stades de leur cycle de vie (construction, exploitation, remise à neuf et déclassement). Des interférences entre ces installations sont possibles, et le déclassement se retrouve souvent relégué à une priorité moindre. La norme CSA N294 (Déclassement des installations contenant des substances nucléaires) fournit des orientations sur le déclassement des sites complexes et le document REGDOC 2.11.2 (Déclassement) exige qu’un plan de déclassement global soit élaboré afin de prendre en compte les interférences potentielles entre les installations qui pourraient survenir lors du déclassement. Malheureusement, la dernière révision de la norme N294 apportera peu d’orientations supplémentaires sur la rédaction d’un plan de déclassement global. Cette présentation examinera l’expérience internationale en matière de rédaction de plans de déclassement globaux pour des sites complexes, ainsi que l’expérience nationale existante. Elle passera également en revue les orientations possibles qui pourraient être incluses dans la révision de 2030 de la norme CSA N294.
Techniques de déclassement – Série 200, Laboratoires de Chalk River
Montana Stein | Laboratoires Nucléaires CanadiensSalle 2035/2036 16 h 10 - 16 h 50
Le campus de Chalk River des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) abrite un ensemble d’installations interreliées, communément appelées les bâtiments de la série 200, comprenant les bâtiments B200A/B, B204 et B220. Ces installations font actuellement l’objet d’un déclassement actif par un groupe spécialisé dans l’assainissement au sein de l’entreprise. Les bâtiments de la série 200 abritaient et traitaient les barres de combustible usé du réacteur expérimental de recherche (NRX).
De nombreuses innovations au niveau des techniques de déclassement ont été utilisées pour la série 200 au fil des ans ; cette présentation se concentre sur les méthodes utilisées en 2024. La majorité des travaux effectués sur la série 200 au cours de l’année a été réalisée dans le bâtiment B204.
Les travées de stockage pour les barres de combustible du B204 sont reliées au NRX par une tranchée. Les travées dans l’installation devaient être blindées et, par conséquent, une planification et une coordination importantes entre plusieurs groupes ont été effectuées afin de réaliser ce travail dans les délais prévus. En raison des débits de dose importants, les mesures ALARA pour ce travail se sont concentrées sur l’utilisation d’outil à distance, d’une télévision en circuit fermé et de balayages par drone, tout en envisageant des méthodes pour réduire le temps que les membres de l’équipe devaient passer dans les champs de rayonnement élevés.
Caractérisation des champs neutroniques autour des déchets de remise à neuf à la centrale nucléaire de Bruce et de OPG par spectrométrie neutronique et modélisation Monte-Carlo
Jovica Atanackovic | Ontario Power Generation et Université McMasterSalle 2035/2036, 15 h 50 - 16 h 10
En utilisant la spectrométrie neutronique, nous avons caractérisé les spectres d’énergie neutronique provenant des composants irradiés d’un réacteur CANDU remis à neuf. Les spectres d’énergie neutronique mesurés provenaient de déchets remis à neuf de tubes de calandre (TC) et de tubes de pression (TP). Les mesures ont été effectuées à l’aide d’un spectromètre neutronique emboîté, fabriqué par la société canadienne DETEC Inc. Elles ont été réalisées à la centrale nucléaire de Bruce, autour d’un seul conteneur de déchets isolé, rempli d’environ 2 000 kg de TP ou de TC qui ont été réduits en petits morceaux et entreposés dans des conteneurs de déchets de retubage, fabriqués presque entièrement en acier à haute teneur en carbone. En utilisant la modélisation de Monte-Carlo et les résultats de cette campagne de spectroscopie, il a été conclu que les champs neutroniques provenant des conteneurs de déchets sont dus à la présence de neutrons de fission spontanée de Cf-252. Il a été constaté que l’origine du Cf-252 dans les TC et les TP provient d’une quantité infime d’U-238 dans les alliages de Zr des TC et des TP. Cet U-238 est converti en Cf-252 après plus de trente ans de bombardement neutronique continu dans un environnement à haut débit de fluence neutronique du cœur d’un réacteur CANDU. En fait, la présence de Cf-252 dans les déchets remis à neuf est le résultat de multiples captures de neutrons et de plusieurs désintégrations bêta. Une autre série de mesures spectroscopiques, après une période de six mois, a permis de mesurer le taux de désintégration du terme source de neutrons dans les conteneurs de déchets de retubage et de confirmer que la demi-vie du Cf-252 est de 2,65 ans. Ces travaux sont les premiers du genre, permettant d’identifier la présence de neutrons de fission spontanée dans les déchets des réacteurs CANDU. Ces résultats ont un impact significatif sur la radioprotection, la dosimétrie, la gestion des déchets et la réglementation en matière de radioprotection.
Mercredi 28 Mai 2025
8:00 am - 9:00 am Conférencier principal - mercredi
La radioprotection à la Centrale nucléaire de Bruce – Notre rôle dans l’exploitation du site et dans l’avenir de la centrale
Zach Brajuha | Centrale nucléaire de BruceSalle 2032, 8 h 00 - 9 h 00
Située sur les berges du Lac Huron, la centrale nucléaire de Bruce fournit de l’énergie nucléaire au tiers des maisons, hôpitaux, écoles et entreprises ontariennes, ainsi que des isotopes médicaux mondialement afin de stériliser les équipements médicaux et assister dans la lutte contre les maladies. Le programme de prolongation de la vie et le projet de remplacement des composantes majeures de la centrale nucléaire de Bruce permettent de prolonger la vie des réacteurs et du site vers l’avenir. Celle-ci alimentera la province en énergie pour les années à venir et ouvrira la voie à des innovations continues dans la production d’isotopes médicaux vitaux. Comme l’Ontario se prépare à l’avenir grâce à son plan « Améliorer la croissance de l’Ontario », la centrale nucléaire de Bruce a débuté une évaluation d’impact fédérale pour le projet Bruce C. Le projet vise à créer une option permettant de développer jusqu’à 4 800 mégawatts de capacité nucléaire à la centrale nucléaire de Bruce. Afin de mener à bien ces travaux sécuritairement, la centrale nucléaire de Bruce gère un programme de radioprotection rigoureux.
Zach Brajuha est le directeur de la radioprotection à la centrale nucléaire de Bruce et présentera le rôle de la radioprotection dans l’exploitation et l’avenir de la centrale.
9:00 am - 10:00 am Séance F: Technologies émergentes
Modérateur: Bryan McIntosh
Leçons tirées de la gestion du changement pour l’installation de production d’isotopes médicaux du CCRS
Darin Street | Centre canadien de rayonnement synchrotronSalle 2035/2036, 9 h 20 - 9 h 40
Le Centre canadien de rayonnement synchrotron (CCRS) détient un permis de catégorie II de la CCSN pour un accélérateur linéaire de 40 kW et 35 MeV, utilisé pour la production d’isotopes médicaux. Le CCRS maintient un programme de radioprotection associé au permis et supervise l’exploitation de l’installation par un entrepreneur. Cette présentation abordera la gestion du changement, les défis en matière de sûreté et les événements récents liés à la radioprotection qui se sont produits lors de la transition de l’entrepreneur qui exploitait l’accélérateur vers un autre entrepreneur qui l’exploite actuellement.
9:00 am - 10:00 am Séance G: Déchets ne provenant pas d’un réacteur
Modératrice: Laila Omar-Nazir
Les exigences canadiennes et internationales pour les scanners de sécurité utilisant des rayonnements ionisants
Laura Boksman | Institut de radioprotection du CanadaSalle 2032, 9 h 20 - 9 h 40
La technologie dépasse rapidement la création de réglementations dans le domaine des scanners de sécurité utilisant des rayonnements ionisants. Il existe différents types de scanners utilisant des rayonnements ionisants, notamment des systèmes conçus spécifiquement pour le contrôle des personnes et d’autres dédiés aux véhicules ou aux conteneurs de fret pouvant contenir des personnes (conducteur·trice ou un·e passager·ère clandestin·e).
Il existe deux principales technologies d’imagerie de sécurité utilisant des rayonnements ionisants : les scanners à rétrodiffusion et les scanners à transmission. La technologie de rétrodiffusion est principalement utilisée pour visualiser des objets cachés sous les vêtements, tandis que les systèmes à transmission sont également utilisés pour visualiser ces objets, mais aussi ceux qui ont été ingérés, cachés dans des cavités corporelles ou implantés sous la peau. En général, la dose de rayonnement reçue par les personnes scannées est beaucoup plus faible avec un système de rétrodiffusion qu’avec un système à transmission.
Les scanners de sécurité utilisant des rayonnements ionisants sont déjà au Canada et leur utilisation est en augmentation. Cependant, le Canada n’a que peu ou pas de réglementation pour ce type de technologie. Il n’existe pas de réglementation canadienne fixant les exigences de conception, de construction et de fonctionnement de ces équipements, pour assurer la protection des personnes. En outre, il n’existe aucune réglementation relative à l’utilisation sécuritaire pour la protection des personnes scannées. Il existe, dans certaines provinces et territoires, des lois pour la protection des travailleur·euse·s utilisant ou évoluant à proximité des systèmes à rayons X, mais pas spécifiquement pour ce type d’appareil et ces lois s’appliquent seulement aux travailleur·euse·s et non aux personnes scannées.
Cette présentation abordera les différents types de systèmes et comment ils sont classés sur la base des normes internationales en raison du manque de réglementation canadienne. Pour les scanners à transmission, entraînant une dose plus importante aux personnes scannées, les recommandations de conception et de fonctionnement des normes internationales seront examinées.
Les programmes de radioprotection pour les scanners de sécurité qui utilisent des rayonnements ionisants
Laura Boksman | Institut de radioprotection du CanadaSalle 2032, 9 h 40 - 10 h
La technologie dépasse rapidement la création de réglementations dans le domaine des scanners de sécurité utilisant des rayonnements ionisants. La présentation précédente a abordé les différents types de ces scanners, y compris des systèmes conçus spécifiquement pour le contrôle des personnes, des véhicules ou des conteneurs de fret pouvant contenir des personnes (conducteur·trice ou un·e passager·ère clandestin·e).
Dans cette présentation, nous explorerons la mise en œuvre pratique des scanners de sécurité utilisant des rayonnements ionisants et les aspects qui devraient être inclus dans un programme de radioprotection pour la protection des personnes scannées, ainsi que pour la protection des travailleur·euse·s. Ceci sera basé sur les normes internationales en raison de l’absence de réglementation canadienne actuellement. La classification des types de scanners a été abordée dans la présentation précédente et ne sera pas répétée ici.
Nous discuterons des principes de radioprotection de justification, d’optimisation et des limites de dose, ainsi que de la façon dont ils s’appliquent au scénario d’exposition prévu pour le contrôle de sécurité des personnes. Des stratégies de réduction des doses seront examinées, ainsi que les limites administratives pour la dose reçue par les personnes scannées et les limites réglementaires ou recommandées pour la dose reçue par les travailleur·euse·s. La nécessité d’élaborer des politiques et des procédures sera examinée et nous discuterons de ce qui devrait être inclus dans ces documents. Les exigences en matière de personnel, y compris la nécessité de fournir une formation aux opérateur·trice·s, aux travailleur·euse·s à proximité et aux responsables de la sécurité des rayons X, seront discutées, ainsi que les recommandations concernant le matériel pédagogique destiné aux personnes scannées.
Façonner l’avenir de la radioprotection : innovations, défis, et possibilités en radioprotection
Lekhnath Ghimire | Université Ontario TechSalle 2032, 9 h - 9 h 20
Cette recherche fournit une exploration approfondie sur le futur de la radioprotection, tenant compte des facteurs externes et internes qui façonnent son développement. Sur le plan externe, cette présentation examine les défis et les priorités associées aux mesures des faibles doses (10-100 mSv) et met en évidence le potentiel des biomarqueurs à transformer la compréhension de la susceptibilité aux rayonnements liée aux expositions aux faibles doses. Les technologies émergentes, tels les scintillateurs en plastique avec la capabilité de discrimination triple et les capteurs à microsphères de scintillation en plastique (PSm), sont examinées pour leur capacité à estimer les radionucléides émettant du rayonnement alpha et bêta dans des échantillons environnementaux.
De plus, les systèmes de détection à distance, incluant les drones, les chiens robots et les capteurs quantiques sont étudiés pour leur sensibilité rehaussée et leur détection précise des rayonnements. L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et l’analyse des données, qui a le potentiel de redéfinir la radioprotection en réduisant les risques d’exposition aux rayonnements est un élément clé. Cette présentation couvre aussi les innovations en matière de matériaux de blindage contre les rayonnements, les progrès dans les applications de la réalité virtuelle et la préparation pour la radioprotection dans les zones de conflit.
Quantification des activités isotopiques à l’aide d’un spectromètre gamma
Brian Bewer | Centre canadien de rayonnement synchrotronSalle 2035/2036, 9 h 40 - 10 h
Lors du fonctionnement des accélérateurs à haute énergie, du matériel activé est souvent créé. L’activité et les isotopes présents dans ces matériaux doivent être caractérisés pour leur élimination et leur rejet de l’installation ou pour déterminer leur durée de séjour dans une zone d’entreposage radiologique. Une méthode d’estimation de l’activité utilisant un radiamètre collecteur de spectre gamma est présentée. En utilisant plusieurs sources radioactives de référence, l’efficacité de détection et le temps mort du radiamètre ont été caractérisés. Ces informations combinées aux propriétés physiques du radiamètre, au temps de comptage et aux propriétés des émissions d’énergie photonique mesurées peuvent être utilisées pour calculer une estimation précise de l’activité lors d’activation localisée de composantes de l’accélérateur ou de contamination non fixée sur les déchets isolés.
Mise en œuvre d’un dispositif économique de surveillance des déchets pour la quantification des radionucléides émetteurs de rayons gamma dans les déchets résultant de la recherche universitaire.
Matt Hutcheson | Université de la SaskatchewanSalle 2035/2036, 9 h - 9 h 20
Au cours des dernières années, la nature des déchets radioactifs provenant de l’Université de la Saskatchewan (USask) a évolué pour inclure des isotopes novateurs produits par accélérateur, des contaminants avec une demi-vie plus longue et des isotopes avec des limites de rejet très restrictives, tel que l’Ac 227. Les méthodes existantes d’estimation conservatrice et de temps de décroissance généreux n’étaient plus pratiques, car la surestimation des concentrations pouvait mener à l’entreposage de larges volumes de déchets pour des décennies. Un dispositif de surveillance de déchets, le MHOS 9700 HWM-S (de ELSE Nuclear), a été acheté pour simplifier la quantification et l’élimination finale des déchets émettant les rayons gamma. Cette présentation résume l’expérience de mise en œuvre d’un dispositif de surveillance de déchets moderne à l’USask pour profiter pleinement de la technologie disponible.
10:30 am - 12:00 pm Séance H: Intervention en cas d’urgence
Modérateur: Jeff Dovyak
Le partenariat en préparation : Renforcer les capacités d’intervention radiologique grâce à la collaboration avec les partenaires communautaires
Chris Malcolmson | Université McMasterSalle 2032, 11 h 10 - 11 h 30
La planification et la préparation aux situations d’urgences radiologiques peuvent s’avérer difficiles. Cette présentation introduira des outils et des stratégies pour atténuer l’impact de ces enjeux. Dans le cadre de ces stratégies, les auteurs proposeront des partenariats communautaires pouvant renforcer les moyens d’intervention et surmonter ces défis. Les relations mutuellement avantageuses entre les premiers répondants de la ville de Hamilton et les spécialistes en radioprotection du Service de radioprotection de l’Université McMaster seront présentées comme un modèle pour améliorer la réponse globale aux urgences impliquant du matériel nucléaire, des rayonnements, une contamination, ou d’autres urgences radiologiques. Enfin, deux études de cas de simulations de situations d’urgence nucléaire à grande échelle, comprenant une intervention coopérative multi-équipe seront présentées. La planification pour les situations d’urgence radiologique est assez difficile, pourquoi le faire seul?
Biodosimétrie par impédance des cellules de levure pour l’évaluation rétrospective des expositions aux rayonnements
Amna Hassan | Laboratoires Nucléaires CanadiensSalle 2032, 10 h 50 - 11 h 10
Les cellules de levure Saccharomyces cerevisiae ont été étudiées en tant que dosimètres fortuits pour les évaluations rétrospectives des expositions à la suite d’accidents radiologiques ou nucléaires à grande échelle. La réponse des cellules de levure aux rayonnements a été examinée en utilisant l’activité métabolique des cellules et l’impédance électrique de la solution pour évaluer la dose. Des cellules de levure sèche active de qualité de laboratoire ont été utilisées comme matériel biologique en raison de leur facilité de manipulation et de leur stabilité à long terme. Un nouveau modèle de dosimètre a été mis au point avec des procédures de fabrication et de mesure précises afin de garantir la reproductibilité des échantillons. Afin d’évaluer la faisabilité de la biodosimétrie par impédance, une courbe dose-réponse a été établie en irradiant des cellules de S. cerevisiae de 0,5 Gy à 8 Gy à l’aide d’une source gamma de ¹³⁷Cs. La courbe dose-réponse a montré une relation linéaire entre la dose et les changements d’impédance. De plus, dans une expérience menée séparément, la limite de détection a été déterminée comme étant égale à 300 mGy. L’atténuation du signal d’impédance a également été examinée et aucune perte de signal n’a été observée sur une période de 7 mois. Enfin, l’impédance et la réponse aux rayonnements de la levure Fleischmann® ont été examinées et il a été constaté que les levures disponibles commercialement présentent une réponse similaire à celle des levures de qualité de laboratoire. Il a été déterminé que les cellules de S. cerevisiae étaient adaptées et pratiques pour des applications en dosimétrie rétrospective grâce à leur disponibilité et à l’absence de traitement additionnel requis. En cas d’accident radiologique, la biodosimétrie par impédance des cellules de levure pourrait être utilisée comme méthode alternative pour évaluer la dose initiale reçue dans les zones exposées.
Une suite d’événements malheureux : Déconstruction des exigences de signalement des incidents relatifs aux MRN
Tanya Vlaskalin | Université métropolitaine de TorontoSalle 2032, 10 h 30 - 10 h 50
Les matières radioactives naturelles (MRN) et les événements associés à ces matières ont « normalement » favorisé la confusion en ce qui concerne leur surveillance dans le cadre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et les règlements en découlant. À la lumière de la résurgence de l’intérêt pour les signalements de garanties, cette présentation examinera un incident qui a mis en évidence la nécessité de comprendre l’utilisation de la dosimétrie pour l’exposition du personnel aux dispositifs émettant des rayonnements et le fait que les signalements ne sont pas toujours noirs ou blancs lorsque l’on fait affaire avec l’organisme de réglementation nucléaire et le fournisseur de services de dosimétrie. Cette présentation mettra en évidence les exigences de signalement et les leçons tirées pour les utilisateurs de rayons X qui ont également accès aux MRN et à des matériaux « non réglementés » en milieu universitaire.
10:30 am - 12:00 pm Séance I: Radioprotection générale
Modératrice: Jennifer Clarke
Les améliorations en radioprotection pour un nouvel irradiateur de recherche autonome à haut débit de dose
Chris Vanderpool | Hopewell Designs, Inc.Salle 2035/2036, 10 h 50 - 11 h 10
Quand des débits de dose élevés sont nécessaires pour des applications industrielles spécifiques, les meilleures pratiques sont d’utiliser des irradiateurs autonomes de recherche. Malgré qu’il soit un des modèles les plus communs depuis des années, le Gammacell 220 a des fuites de rayonnements qui contribuent à la dose des travaillleur·euse·s. Le modèle GR420 par Hopewell Designs est destiné à remplacer le GC220 sur le marché et à améliorer la radioprotection. Le blindage et les mécanismes de sûreté sont conçus pour limiter les débits de dose à 20 µSv/h à 30 cm, grâce au système d’enceinte blindée, pour tous les modes de fonctionnement (lors du chargement/déchargement, irradiation et transition). Cette présentation comprend un aperçu de la conception de l’irradiateur GR420 et des débits de dose autour de l’appareil pour tous les modes de fonctionnement, ainsi que les améliorations notables en matière de sûreté et de fonctionnement par rapport à l’ancien GC220.
De la physique nucléaire à la radioprotection : Naviguer un changement de carrière au-delà des frontières
Clauzi Guerini | TRIUMFRoom 2035/2036, 10 h 30 - 10 h 50
Il n’est jamais facile de changer de carrière d’un pays à l’autre, surtout dans un domaine spécialisé comme la radioprotection. Dans cette présentation, je partagerai mon parcours professionnel d’un poste de responsable de la radioprotection (RRP) dans le secteur de la santé au Brésil jusqu’à une carrière en radioprotection au Canada.
À mon arrivée au Canada, j’ai été confronté à des défis communs à de nombreux·euses professionnel·le·s – naviguer dans un nouveau marché de travail, comprendre des cadres réglementaires différents et fournir mon expertise dans un domaine concurrentiel. Je parlerai des stratégies que j’ai utilisées pour percer dans l’industrie canadienne de la radioprotection, notamment le réseautage, le développement professionnel et la mise à profit de mon expérience antérieure pour décrocher mon premier poste.
Ayant commencé comme inspecteur de la radioprotection et je me suis rapidement adapté aux aspects opérationnels de la radioprotection dans un nouvel environnement. Mon expérience en dosimétrie et en conformité réglementaire m’a permis de passer à un poste de spécialiste en dosimétrie, où j’ai contribué aux programmes de surveillance des rayonnements et aux améliorations de la sûreté. Grâce à mon dévouement et à ma croissance continus, j’ai finalement accédé à mon poste actuel de chef du groupe de radioprotection opérationnelle dans un laboratoire d’accélérateurs.
Cet exposé vise à inspirer et éclairer les professionnel·le·s qui souhaitent faire une transition dans ce domaine, qu’il s’agisse de nouveaux·elles arrivant·e·s au Canada ou de personnes souhaitant réorienter leur carrière. Je soulignerai les principales leçons apprises, l’importance de l’adaptabilité et comment l’expérience internationale peut être un atout dans un nouvel environnement professionnel.
Enquête comparative de (et des solutions pour) la réglementation canadienne sur la sécurité laser en milieu de travail
Randolph Paura | Dynamic Laser Solutions, Inc.Salle 2035/2036, 11 h 10 - 11 h 50
La prolifération de la technologie laser a considérablement abaissé la barrière à l’entrée, conduisant à une adoption généralisée dans diverses industries. Toutefois, cette intégration rapide a dépassé la compréhension des dangers inhérents aux lasers, ce qui a donné lieu à des idées fausses et à des lacunes dans les connaissances concernant les pratiques conformes et sécuritaires en milieu de travail.
Premièrement, cette présentation vise à identifier et à discuter des principes internationaux et des orientations internationales en matière de sécurité laser en milieu de travail, qui reposent sur l’acquisition d’un équipement conforme permettant une utilisation sécuritaire. Elle identifie les principes de base internationaux pour les limites d’exposition pour la sécurité des lasers en milieu de travail, fixées par l’ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) et les mesures de contrôle proposées par l’OIT (Organisation internationale du Travail). Les normes consensuelles relatives à la construction des équipements et à la sécurité des utilisateurs seront examinées afin de s’assurer de la compréhension des meilleures pratiques mondiales.
Suivant cette base universelle, nous examinons la réglementation canadienne en matière de sécurité laser en milieu de travail, y compris les dispositions fédérales, provinciales et territoriales. Une explication de ce que signifient les clauses d’obligation générale et de diligence raisonnable des règlements sur la santé et la sécurité du travail sera présentée et nous aborderons les idées fausses à ce sujet. Cette section se penche sur les cadres réglementaires spécifiques et les protocoles de sécurité imposés par les différentes juridictions du Canada. Les lacunes apparentes ne doivent pas être interprétées comme un relâchement des exigences en milieu de travail, car les professionnels en santé et de la sécurité au travail et en droit se réfèrent aux meilleures pratiques.
Finalement, cette présentation proposera une page Web d’informations en santé et sécurité au travail comme source de référence sur la sécurité laser en milieu de travail fondée sur les meilleures pratiques internationales en santé et sécurité au travail. Cette page Web vise à servir d’outil de base afin d’offrir une orientation et des ressources détaillées pour assurer des activités laser en milieu de travail conformes aux règlements et sécuritaires pour toutes les parties prenantes.
1:30 pm - 3:00 pm Séance J: L’avenir de la radioprotection
Modérateur: Jeff Fleming
Réévaluation du modèle linéaire sans seuil : Le rôle de la technologie des organes sur puce
Charles Wilson | Université d’Alabama de BirminghamSalle 2032, 13 h 50 - 14 h 10
Le modèle linéaire sans seuil, qui constitue depuis longtemps la base de la réglementation des rayonnements, fait l’objet d’un débat scientifique important et persistant quant à sa précision aux faibles doses (sous 10 cSv/an). Des études récentes n’offrent pas de solution concluante, les résultats étant répartis entre le modèle LNT, les modèles de risque non linéaires et les modèles hormésiques. De plus, la recherche se développe sur le rôle potentiel des rayonnements dans les maladies non cancéreuses telles que les maladies cardiaques, la maladie de Parkinson et le diabète. Alors que le modèle linéaire sans seuil engendre l’inquiétude du public et des efforts de remédiation coûteux, il demeure la norme réglementaire en raison du manque de preuves pour des alternatives. Pour y remédier, des recherches plus approfondies utilisant des techniques avancées (p. ex., apprentissage automatique, analyse des données edisoniennes) combinées à un modèle de laboratoire qui reproduit plus fidèlement les résultats in vivo sont en cours. La technologie des organes sur puce améliore significativement la capacité de reproduire les conditions in vitro pour plusieurs organes d’intérêt et leurs diverses interactions dans l’étude de la pharmacocinétique et de la radiobiologie. Cette présentation donnera un aperçu des études actuelles sur le modèle linéaire sans seuil et les organes sur puce, en mettant l’accent sur les avantages de cette technologie pour les études sur les rayonnements à faible dose et à faible débit de dose.
Faire face au déclin des programmes universitaires de radioprotection : Défis, solutions et opportunités pour l’aveni
Emily Caffrey | Université d’Alabama de BirminghamSalle 2032, 14 h 10 - 14 h 30
Cette présentation mettra en évidence le statut des programmes universitaires de radioprotection en Amérique du Nord, présentera des solutions potentielles et partagera certaines opportunités pour les experts du domaine afin de maximiser leur impact sur la prochaine génération. Le besoin en physiciens en radioprotection ne cesse de croître avec les nouvelles conceptions de réacteurs, l’augmentation des nouveaux produits radiopharmaceutiques, la nécessité de gérer les scénarios d’exposition environnementale et le potentiel imminent d’exploitation de l’énergie de la fusion nucléaire. La capacité à prévoir les questions de sécurité de demain, à résoudre les problèmes d’hier et à enseigner à la prochaine génération dans le domaine de la radioprotection est vitale. La tendance à fermer des programmes universitaires et le manque de relève dans l’industrie ont été annoncés dans la déclaration 12 du National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) publiée en 2015 intitulée « Where are the Radiation Professionals? » et ont été réitérés récemment dans Physics Today [1], dans le Bulletin of the Atomic Scientists [2] et dans le Journal of Applied Clinical Medical Physics [3]. En avril 2023, la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) a publié un article issu de son symposium de Vancouver en 2022. L’article indique que la CIPR est « … préoccupée par le fait qu’un manque d’investissement dans la formation, l’éducation, la recherche et les infrastructures a été observé dans de nombreux secteurs et pays pouvant compromettre la capacité de la société à gérer correctement les risques liés aux rayonnements et pouvant entraîner une exposition ou une peur injustifiée des rayonnements, ce qui aurait un impact sur le bien-être physique, mental et social de nos populations » [4]. L’article appelle à une action mondiale pour renforcer l’expertise en matière de protection radiologique. Les États-Unis ne comptent plus que sept programmes d’études supérieures actifs, le Canada deux et le Mexique aucun. Le manque d’experts entrant dans le domaine est également mis en évidence par le nombre d’experts désireux et capables d’enseigner. L’Université McMaster et l’Université d’Alabama de Birmingham se sont associées pour partager leurs compétences et leurs installations afin d’optimiser le transfert d’informations à la prochaine génération.
[1] https://pubs.aip.org/physicstoday/article/76/10/18/2912730/Alarm-sounded-over-declining-US-radiation
[2] https://thebulletin.org/2023/07/nuclear-safety-staffing-in-the-united-states-a-crisis-with-no-easy-fix/
[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9880967/
[4] https://link.springer.com/article/10.1007/s00411-023-01024-5
1:30 pm - 3:00 pm Séance K: Surveillance environnementale
Modérateur: Lionel Fernandes
Considérations concernant les quantités de doses opérationnelles proposées par l’ICRU 95
Josip Zic | Université McMasterSalle 2032, 13 h 30 - 13 h 50
En 2021, la CIPR a entamé la révision des recommandations générales du système de radioprotection et une partie se concentrera sur les quantités de doses. La publication 147 de la CIPR et le rapport 95 de la Commission internationale des unités et des mesures de radiation (ICRU) récemment publiés décrivent l’étendue des modifications proposées et ouvrent la voie à la stratégie à adopter. Ces révisions viseraient à simplifier, à améliorer la précision et à étendre le champ d’application des quantités de doses. Bien qu’il y ait une amélioration notable dans l’estimation des quantités de protection et l’utilité de tels changements pour le secteur médical et en recherche, les avantages du système proposé semblent limités pour l’industrie nucléaire et les industries impliquant des matières radioactives naturelles (MRN). De plus, la complexité associée à la modification d’un système robuste et établi depuis de longue date semble injustifiée, étant donné le coût probable. Toutes les organisations qui mettent en œuvre des technologies nucléaires devraient évaluer l’impact des changements proposés dans la mesure où ils s’appliquent à la mise en œuvre de leurs programmes de radioprotection et à la communication des risques radiologiques aux travailleur·euse·s et au public.
La dosimétrie environnementale et son rôle dans la surveillance radiologique d’un océan à l’autre
Nick Maddox | Santé Canada/Services nationaux de dosimétrieSalle 2035/2036 14 h 10 - 14 h 30
Les Services nationaux de dosimétrie (SND) de Santé Canada gèrent un petit programme de dosimétrie environnementale afin de soutenir les efforts de la Section de surveillance nationale (SSN) de Santé Canada visant à caractériser la composante gamma des débits de fond à travers le Canada. Des dosimètres environnementaux passifs (conception Landauer Inlight) sont distribués trimestriellement aux stations de la SSN situées dans chaque province et territoire. Ils sont ensuite déployés et récupérés par les partenaires de la SSN. Un algorithme spécialisé traite les éléments de luminescence stimulée optiquement (LSO) du dosimètre pour calculer l’équivalent de dose ambiant H*(10). Ces données sont ensuite transmises à la SSN, qui publie les résultats sur le site web de la dosimétrie environnementale du Réseau canadien de surveillance radiologique (https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/67bedee8-beb0-4b3a-a1c6-24a4cda08afe). L’accent serait mis sur la justification du choix de la dosimétrie environnementale passive et sur la conception des dosimètres.
La perspective d’une durabilité radiologique par la réutilisation des résidus de MRN dans les matériaux de construction.
Esther Osei Akuo-ko | Université de PannonieSalle 2035/2036, 13 h 30 - 13 h 50
Les matériaux terrestres contiennent des radionucléides naturels, notamment l’uranium 238, le radium 226, le thorium 232 et le potassium 40, qui sont importants pour la radioprotection. Ces résidus de matières radioactives naturelles (MRN) sont produits en grandes quantités et présenteraient un grand intérêt économique s’ils étaient, dans une certaine mesure, incorporés dans des mélanges ou comme additifs dans la production de matériaux de construction, ce qui permettrait des options de réutilisation flexibles en fonction du produit final et réduirait ainsi les effets radiologiques potentiels sur les humains et sur l’environnement. Ainsi, la réutilisation des résidus de MRN est une méthode rentable et respectueuse de l’environnement qui permet de réduire les impacts radiologiques potentiels sur les humains, de préserver les ressources naturelles, de réduire les émissions de CO2 et d’économiser l’énergie. La directive européenne sur les normes de sécurité de base stipule que les MRN doivent être caractérisées en tant que matières premières secondaires destinées à être utilisées dans les matériaux de construction. Quelle que soit leur origine, le comportement radiologique et les propriétés matérielles des MRN en tant qu’additif ou matériau secondaire sont essentiels. De façon générale, la première considération pour atteindre la durabilité radiologique est de recycler ou de réutiliser les résidus ou les sous-produits contenant des MRN au lieu de les éliminer comme des déchets. L’accent est mis sur la réutilisation des matériaux comme matériaux de construction et sur la recherche d’une durabilité radiologique. Cette étude examine donc le potentiel de reproduction des résidus de MRN en se basant sur leurs propriétés et le traitement approprié avant la réutilisation. L’évaluation de leurs indices radiologiques est utile pour catégoriser les résidus de MRN avant leur utilisation dans les matériaux de construction. Ces indices donnent une meilleure indication du risque d’exposition externe par rapport à la concentration d’activité spécifique de l’uranium 238, du radium 226, du thorium 232 et du potassium 40. Les résultats de l’étude indiquent que l’incorporation de résidus de MRN dans des mélanges ou leur utilisation comme additifs peut diminuer la concentration d’activité et les indices dans le résidu d’origine, permettant des options de réutilisation flexibles en fonction du produit final.
Une étude radiologique complète des sols et des ressources en eau dans les zones d’exploitation artisanale de l’or au Ghana : Activités minières et risques radiologiques.
Esther Osei Akuo-ko | Université de PannonieSalle 2035/2036, 13 h 50 - 14 h 10
L’activité minière mondiale a fortement augmenté en réponse à la hausse de la demande et des prix de l’or au cours des deux dernières décennies. L’exploitation minière a été reconnue comme une source potentielle d’exposition radiologique dans l’environnement. Des études sur les radionucléides naturels, les concentrations d’activité du radon et les taux d’exhalaison du radon dans les sols et dans les ressources en eau de surface et souterraine ont été menées dans certaines zones d’extraction de l’or au Ghana. Les concentrations d’activité du radium 226, du radium 228, du thorium 232 et du potassium 40 dans les échantillons de sol et d’eau ont été analysées à l’aide d’un détecteur de rayons gamma au germanium de haute pureté, tandis que la concentration d’activité du radon et les taux d’exhalaison du radon dans les sols ont été déterminés à l’aide de détecteurs passifs de radon (CR-39) et de chambres d’exhalaison. Les données obtenues des mesures de la radioactivité indiquent que les sols des régions étudiées présentent des concentrations d’activité élevées en thorium 232 par rapport au radium 226. Les concentrations d’activité et les taux d’exhalaison du radon étaient plus élevés dans les sols des zones agricoles et des sites miniers que dans les zones résidentielles et non perturbées. Les ressources en eau de surface et en eau souterraine ont enregistré des niveaux élevés des radionucléides mesurés, supérieurs aux valeurs moyennes mondiales de 0,1 Bq/L pour le radium 226 et de 1,0 Bq/L pour le radium 228. Les eaux souterraines prélevées dans les zones situées à proximité des sites miniers ont enregistré des concentrations de radioactivité plus élevées. Ceci pourrait être attribué aux activités minières artisanales qui entraînent la lixiviation et l’infiltration de radionucléides dans les substrats rocheux, les aquifères et les ressources en eau avoisinantes, ainsi qu’au fait que les mineurs lavent directement les minerais d’or et l’équipement minier dans les plans d’eau de surface. Les risques radiologiques évalués associés à l’ingestion et à l’inhalation de radionucléides dus à l’exploitation minière se sont révélés élevés, en particulier pour les ressources en eau. Les études ont donc montré que l’extraction, le transport et le traitement des minerais d’or, ainsi que l’utilisation des résidus miniers, exposent directement les mineurs et la population aux rayonnements ionisants et présentent donc des risques radiologiques.
Jeudi 29 Mai 2025
9:00 am - 10:00 am Conférencier principal - jeudi
Créer l’avenir ensemble : Plan canadien pour le combustible nucléaire irradié
Kelly Liberda | Société de gestion des déchets nucléairesSalle 2032, 9 h 00 - 10 h 00
La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est une organisation à but non lucratif chargée de la gestion sécuritaire et à long terme de combustible nucléaire irradié dans un dépôt géologique en profondeur (DGP), de manière à protéger les personnes et l’environnement pour les générations à venir.
En 2024, la SGDN a sélectionné la Nation ojibwée du lac Wabigoon et le canton d’Ignace comme communautés hôtes pour le futur site du dépôt géologique en profondeur (DGP) pour le combustible nucléaire irradié du Canada. Cette décision historique de sélection du site s’appuie sur les priorités identifiées lors de consultation avec les populations canadiennes et autochtones au début du processus : le site peut contenir et isoler sécuritairement le combustible nucléaire irradié au Canada, le combustible nucléaire irradié peut être transporté sécuritaires au site et les municipalités et les Premières Nations hôtes ont confirmé au niveau local qu’elles soutenaient la poursuite du projet dans leur région.
Alors que l’annonce de la sélection du site représente un moment historique pour la SGDN, les Canadien·ne·s et les Premières Nations, elle ne marque pas la fin du processus. Les prochaines étapes comprennent le processus décisionnel réglementaire et la poursuite du vaste programme de consultation publique. Cela sera soutenu par des études techniquescontinues, notamment la caractérisation du site, l’élaboration de la conception de l’installation et du système de barrières multiples et les analyses de sûreté. Les analyses de sûreté servent à démontrer que les activités, tout au long des phases du cycle de vie de l’installation, répondront aux critères de sécurité réglementaires. Cela se fait en partie en démontrant que, dans de nombreux scénarios, tant probables qu’improbables, les impacts calculés sur les travailleur·euse·s de l’installation, le public, la flore, la faune, l’eau et l’environnement à proximité de l’installation respecteraient les critères de sûreté et qu’ils seraient bien en deçà des limites réglementaires.
10:30 am - 12:00 pm Séance L: Regulatory (French)
Modérateur: Ali Shoushtarian
L’avenir c’est maintenant: Améliorations àvenirdans le processus d’octroi de permis de la CCSNet rationalisation de votre permis
Diana Moscu | Commission canadienne de sûreté nucléaireSalle 2032, 10 h 30 - 10 h 50
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) s’efforce de moderniser ces méthodes de travail. La mise à jour des documents réglementaires en temps opportun assure que le cadre réglementaire est aligné avec les exigences internationales et tient compte de l’expérience opérationnelle et des commentaires des titulaires de permis. Des travaux sont en cours pour soutenir l’innovation des nouvelles technologies, des petits réacteurs modulaires et de la thérapie protonique jusqu’aux développements réalisés dans les universités et les cliniques. La CCSN met en place des processus permettant d’autoriser des dispositifs, des projets et des expériences, de la paillasse jusqu’à la commercialisation.
Une autre initiative de modernisation de la CCSN vise l’amélioration des outils numériques utilisée par le personnel dans ses activités quotidiennes. Ceci peut se traduire par des demandes de permis plus simples, un meilleur partage de matériel numérique et la fin d’envoi de documents physiques par la poste. Ce processus permet plusieurs possibilités de simplification des permis de la CCSN, facilitant la gestion et améliorant les activités quotidiennes aux installations autorisées. En travaillant ensemble, la CCSN et les titulaires de permis peuvent s’assurer que nous apprenions tous et nous adaptions aux défis de l’avenir tout en protégeant l’environnement et en assurant la sûreté et la sécurité nucléaires pour tous les Canadien·ne·s.
Cette présentation abordera la modernisation en cours à la CCSN et son impact potentiel sur les titulaires de permis.
Performance en radioprotection en médecine nucléaire : Tendances et conseils
Lindsay Pozihun | Commission canadienne de sûreté nucléaireSalle 2032, 10 h 50 - 11 h 10
Chaque année, la CCSN examine les données sur le rendement de ses titulaires de permis afin d’identifier les tendances et de guider ses efforts en matière de réglementation. Ces dernières années, le sous-secteur de la médecine nucléaire a connu une baisse significative de son rendement dans le domaine de la sûreté et du contrôle de la radioprotection.
Cette présentation donnera un aperçu des données de conformité de la médecine nucléaire au Canada. Elle décrira les non-conformités les plus fréquentes et fournira des conseils sur les moyens d’améliorer la conformité dans ces domaines. L’accent sera mis sur l’instrumentation, y compris leur sélection, leur étalonnage et leurs utilisations. Elle couvrira également les meilleures pratiques observées chez certains de nos titulaires de permis les plus performants.